À l’image de son modèle américain, le comic-book s’est longtemps consommé en kiosque sur le territoire français. Les magazines SEMIC comme Strange et Nova ont amené plusieurs générations de lecteurs vers les super-héros Marvel ou DC. À l’heure actuelle, on ne peut plus trouver un seul de ces magazines en maison de la presse ou kiosque à journaux. Mais si le format du comics kiosque est mort aujourd’hui, qui est le coupable de cette disparition ? Zoo a mené l’enquête, entre décisions marketing des éditeurs, évolution des pratiques des consommateurs et errements du système de distribution de la Presse française.

Le rituel était incontournable : guetter les dates de sorties et chaque mois, se rendre à son bureau de tabac ou son marchand de journaux pour trouver les magazines de comics qui s’y vendaient. De très nombreux lecteurs sont venus aux comics de super-héros par l’entremise de la presse BD. Car si la bande dessinée franco-belge a globalement délaissé ce mode de publication depuis le milieu des années 90, c’est une pratique qui a duré jusqu’en 2020 pour de nombreux fans.
Dernier soubresaut en date, la disparition du magazine Batman Bimestriel d’Urban Comics, supprimé des programmes de l’éditeur au cours du confinement. Avant cela, Panini Comics avait quitté les kiosques pour les réseaux librairies et Relay, autour de leur offre « softcover », scellant le cercueil de ces sorties, tel celui mort-vivant en juillet 2018.
Un mode de consommation aux multiples avantages
S’il est indéniable que le comics kiosque a longtemps bénéficié d’une forme de fidélité des lecteurs à un format « madeleine de Proust », il ne faut pas écarter le fait que cette proposition avait de nombreux avantages pour les lecteurs.

Un rapport prix/pages en faveur des français
Le premier d’entre eux, a longtemps été son rapport qualité prix imbattable. Pour François Hercouët, directeur éditorial d’Urban Comics, cette dimension est incontournable : « C’est la manière la plus économique de consommer cette passion. Pendant longtemps, vous pouviez acheter 4 magazines à 4 euros et un album en librairie pour le même prix. Avec quatre fois plus de lecture via le kiosque. »
Si les prix des formats magazines ont évolué à la hausse avec le temps et l’inflation des matières premières, ce rapport favorable ne se dément toujours pas. Kader Chaibi, propriétaire de la librairie spécialisée Comic Zone, à Lyon le constate aujourd’hui encore : « Les éditeurs français ont toujours proposé un produit moins cher mais plus qualitatif que la VO, avec du papier de bien meilleure qualité. D’ailleurs certains de mes clients qui ont acheté les comics US, rachètent House of X/ Power of X en softcover chez Panini afin d’en garder une version plus solide. »
Un format favorisant la découverte d’autres séries
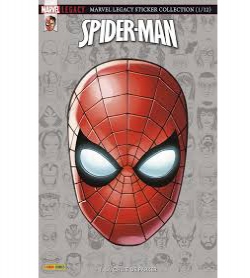
L’autre grand avantage de la lecture en magazine, c’est l’ouverture qu’elle offre aux lecteurs. Depuis 1998 et l’arrivée de Panini Comics (Marvel France à l’époque), chaque titre est thématisé de sorte que le lecteur puisse retrouver des titres spécifiquement rattachés à une partie de l’univers d’un éditeur : Justice League Rebirth (Urban Comics) proposait les titres de l’équipe DC et de ses héros affiliés, Spider-Man (Panini Comics) propose les différentes séries liées au tisseur de toile et même Top Comics (Delcourt) rassemblait les super-héros du label Top Cow. Sébastien Dallain, Directeur de la division « publishing » chez Panini Comics, se souvient : « Quand Marvel décide de réattribuer la licence française à Panini, dont l’entreprise était propriétaire, Marco Lupoi mon responsable avait déjà mené cette entreprise de regroupement par famille. L’offre éditoriale était jusque-là complexe en France, notamment pour le suivi des crossovers, nous l’avons simplifiée et étendue. »
Alors même si le lecteur peut cibler son personnage préféré et ne rien lire des autres, les éditeurs veillent à remplir leurs magazines avec des séries de visibilité moindre. Ce qui permet aux lecteurs et lectrices de les découvrir malgré tout. Les séries blockbusters soutiennent la présence de ces outsiders, avec la possibilité de servir de rampes de lancement pour ces mêmes titres. « Quand nous avons lancé Urban Comics, nous dit François Hercouët, nous nous sommes posé la question de la place que nous allions donner à la série Nightwing New 52. Pour ma part, je ne pensais pas qu’elle avait le potentiel pour vendre en librairie. Nous l’avons donc inséré dans le magazine des titres Batman. Mais après quelques numéros, les retours des lecteurs français étaient tellement positifs que cela nous a incité à en proposer un format album. Qui a en effet bien fonctionné. Sans cette prépublication, jamais nous n’aurions osé prendre ce risque. Mais nous sommes attentifs à nos lecteurs, ce sont eux qui détiennent la vérité finale. »
Une diffusion au plus près du lectorat
Le troisième grand avantage du comics kiosque, c’était son mode de diffusion. Il y a moins de librairies que de kiosque et bureaux de tabac. Si un lectorat informé se lance dans l’achat de comics en librairie spécialisée, ce n’était pas le cas du comics kiosque pour Xavier Fournier, essayiste et ancien rédacteur en chef du magazine spécialisé Comic Box : « L’achat du comics en kiosque, c’était un achat d’impulsion. C’était la mère de famille, le grand-père qui, en revenant du marchand de journaux, tendait un magazine pas cher pour occuper le jeune qui s’ennuyait à la maison. Et de nombreux lecteurs ont commencé avec cette lecture épisodique avant de se lancer dans un suivi régulier de leur nouveau magazine. Aujourd’hui, on perd ce premier lecteur inattendu. »
Autant d’avantages pertinents dont il n’est pourtant désormais plus possible de bénéficier.
Les éditeurs ont-ils tué le comics kiosque ?
La rengaine parcourt forums et réseaux sociaux depuis plusieurs années. Si les comics kiosque ont disparu, c’est la faute de Panini Comics, ses multiples numéros 1 et ses hausses de prix régulières. Ou alors, c’est la faute d’Urban Comics, qui n’a jamais cru au kiosque, parce qu’en tant qu’entité liée à Dargaud et Dupuis, seul l’album compte. Ceux qui soutiennent la première assertion sont souvent dithyrambiques sur le second éditeur et inversement. Ce sont là des guerres de clochers, des joutes de fans qui ne reposent pas sur la réalité.

Des professionnels passionnés de ce média
« Souvent, le public se dit que les décisions sont prises hors-sol. Mais c’est ignorer que ces décideurs sont avant tout des fans. » nous confie Xavier Fournier.
Et c’est le cas. Thierry Mornet, éditeur Delcourt Comics est tellement impliqué, qu’il est le scénariste de french comics intitulés Le garde républicain. François Hercouët, pour Urban Comics, considère le kiosque « comme un rite [qu’il a connu] lui-même et pour lequel [il a] beaucoup d’affect. » Aurélien Vivès, éditeur du magazine Star Wars pour Panini Comics, fut d’abord un forumeur passionné. Olivier Jalabert, directeur éditorial Glénat Comics, est capable de citer son tout premier : « Strange #52. Je revois encore la couverture de 1974. » Sullivan Rouaud, en charge du label Hi Comics chez Bragelonne, a fondé le site de news Comics Blog.
Quelle que soit la taille de l’éditeur, les passionnés sont présents aux manettes. Et ils ont tous été biberonnés au comics kiosque !
Une trop grande profusion de magazines ?
Est-ce donc à dire qu’il faut exonérer les maisons d’édition de toute responsabilité ? Pour le libraire Kader Chaibi, sûrement pas : « Il y a eu clairement une surenchère inappropriée entre Urban et Panini. L’arrivée d’Urban en kiosque s’est faite sur un format pas judicieux à mon sens. Un format à dos carré collé, avec toujours plus de pages, plus cher. On s’éloignait du but du fascicule : avoir une lecture facile, rapide, très accessible. Et Panini a suivi cette nouvelle tendance. »

Thierry Mornet, qui fût aussi le rédacteur en chef des éditions SEMIC jusqu’en 2004, se pose une question sur cette époque passée : « Est-ce que nous ne nous sommes pas livrés à une sorte de course à l’échalote ? Avec SEMIC, nous proposions dix magazines à un moment donné, Panini en proposait autant… Je crois qu’il est légitime d’interroger le volume de sorties, face à des portefeuilles de lecteurs qui n’étaient pas sans fond. » Un questionnement que corroborent Sébastien Dallain et Olivier Jalabert, certes directeur éditorial aujourd’hui, mais alors libraire à Album Dante Paris : « Les années 90 ont été des années flamboyantes pour le comics kiosque français. A la sortie du Deadpool #1 de Joe Kelly et Ed McGuinness, j’ai vendu 60 comics VO pour 300 exemplaires de la VF de Panini. Mais la décennie suivante a vu trop de titres publiés, les acheteurs n’avaient clairement plus les moyens de tout suivre. »
Une vision que ne partage pas complètement François Hercouët : « La politique éditoriale de la concurrence a un mérite, elle ramène des lecteurs différents vers les points de ventes et vers les produits que nous proposons. Nous en bénéficions toujours d’une manière ou d’une autre, parce que le lectorat n’est pas fermé. En achetant le produit des concurrents, il se laisse tenter à l’occasion par nos propres propositions. »
Des prix trop élevés ?
La hausse régulière des prix peut-elle expliquer la perte de lecteurs ? Entre 2016 et 2020, lire un magazine au format souple consacré aux Avengers, chez Panini, coûte 4 € de plus. Des hausses de tarifs sur lesquels l’éditeur communique une fois en décembre 2019 :
Lire la suite du post de Panini
« Il y a réellement eu une hausse importante du prix du papier ces dernières années » développe Thierry Mornet. « Nous, éditeurs, ne pouvions faire autrement que de répercuter ces hausses de coûts sur les prix. » Sébastien Dallain, identifie un coût supplémentaire dont on parle rarement : « Le coût des licences. Nous étions deux éditeurs au début des années 2000, nous sommes désormais une dizaine à lutter pour leur acquisition. La concurrence jouant, on ne saurait blâmer Marvel, DC Comics ou tout autre : les prix augmentent à leur tour. Pour que ces traductions restent rentables, ce sont des surcoûts qu’il nous faut prendre en compte. » Pour ce qui concerne le seul Panini et son offre Softcover, Sébastien Dallain va plus loin : « en quittant le kiosque, nous avons dû faire face à un coût de distribution qui ne nous permettait plus de proposer des comics souples à 6 €. Nous n’avions pas le choix que de procéder à cette évolution. »
Mais si les réseaux sociaux se sont offusqués, ces hausses de prix ont-elles été suivies de baisse des ventes ? Concernant le réseau des libraires spécialisés, Kader Chaibi n’a pas mesuré d’évolution sur sa clientèle lyonnaise. « Malgré ces hausses de tarifs, le prix par rapport à la VO reste en faveur de la VF, avec en plus un objet de bien meilleure qualité. Les lecteurs restent. » Chez Panini, on reconnait que les hausses ont eu des répercussions sur les ventes au fil des années, mais on reste optimiste. « Nous avons vraiment eu peur de perdre les lecteurs du kiosque et de ne conserver que les lecteurs librairies. Pourtant, après deux années sur ce nouveau format, nous avons retrouvé un niveau de ventes proche des deux réseaux combinés de l’époque. »
Des relaunchs déstabilisants ?
Autre pratique souvent questionnée, tant pour Urban Comics que Panini, le « relaunch ».
Régulièrement, les magazines étaient arrêtés, renommés et relancés au numéro 1. Une pratique qui agace les collectionneurs amateurs mais qui a pourtant eu de réels effets, selon Sébastien Dallain : « Soyons clair. Un relaunch voyait les ventes augmenter de 30 à 50%. C’est une pratique marketing qui a une réelle efficacité pour stimuler les ventes. Cela étant dit, ces relaunches étaient aussi guidés par ceux impulsés par Marvel. Nous avons fait en sorte de nous appuyer au maximum sur des relances qui aidaient les lecteurs à reprendre pied dans ces univers au démarrage d’une remise à zéro. Pour les mettre au service de l’éditorial. Sans cela, nous aurions arrêté le kiosque bien plus tôt, faute de ventes suffisantes. »
Les éditeurs ont-ils suffisamment défendu le kiosque ?
Il faut bien le dire, les chiffres de ventes se sont effondrés au fil des années. Quand Strange pouvait se vendre à 80 000 exemplaires dans les années 80, il n’y avait plus que 20 000 ventes environ sur le Fathom n°1 de SEMIC. Vendre 10 000 exemplaires sur les formats kiosque/softcover est aujourd’hui considéré comme une bonne performance.
Pour autant, les éditeurs ne sont pas restés inactifs. « Je crois bien que Panini est un des premiers et des rares que j’ai vu faire de la publicité hors du monde des comics pour ses produits » estime Xavier Fournier. Kader Chaibi note lui aussi l’investissement de l’éditeur européen dans des produits destinés à relancer l’intérêt pour le kiosque : « Si beaucoup de jeunes arrivent aux comics via Urban, par les films et séries DC Comics, c’est Panini que j’ai vu essayer de développer de vraies offres marketing pour soutenir le format kiosque. Les variant cover, qui sont incontournable aux US, c’est Panini. Le coffret Secret Wars avec le premier numéro et une boîte, c’était eux aussi. On ne peut pas dire qu’ils n’ont rien fait pour le kiosque. »

Le cinéma a-t-il créé de nouveaux lecteurs ?
Cette question de l’influence des sorties cinéma sur les ventes de comic-book est régulièrement posée dans les discussions entre fans de comics. Le lien se fait-il ? Les spectateurs se rendaient-ils vers les kiosques ? François Hercouët répond : « Clairement, le magazine Suicide Squad Rebirth était positionné pour profiter de l’engouement généré notamment par le personnage de Harley Quinn dans le film. Nous avons amené de nouveaux lecteurs vers le comics kiosque, mais sans qu’ils ne restent et sans qu’ils ne se dirigent vers d’autres magazines. » Sébastien Dallain, à une époque, a aussi bénéficié de ces effets d’attractivité, mais qu’il associe plus aux titres publiés en librairie : « Nous avons eu la chance de démarrer avec la sortie des X-Men de Bryan Singer, puis du Spider-Man de Sam Raimi. Et ce coup de projecteur sur les personnages se retrouvaient sur les ventes d’albums. Quand en 2008 est sorti Iron Man de Jon Favreau, nous avons vu décoller à leur tour les titres Avengers. » La question est donc de comprendre pourquoi et comment les lecteurs ont fuit un format avantageux pour eux.
La librairie a-t-elle terrassée le comics kiosque ?
Les propositions éditoriales font le visage du marché. Les choix d’arrêter des magazines, de quitter complètement les kiosques, sont des responsabilités d’éditeurs. Mais ces choix, parfois radicaux, répondent à des situations qui ne dépendent pas que de leur propre vision comptable. Pour comprendre pourquoi les comics ont disparu des marchands de journaux en France, il faut donc prendre en compte ces dimensions particulières.
Il faut donc d’abord parler du lectorat. Un public fidèle, fondamentalement, tous nos interlocuteurs se retrouvent sur ce point. Des consommateurs capables de se rendre chaque mois, avec rigueur, dans leur point de vente pour retrouver la suite des aventures de leurs héros préférés.
Les habitudes des lecteurs ont changé
Mais exprimé ainsi, ce public n’était pas très différent du lectorat de bande dessinée franco-belge ainsi qu’on le connaissait jusque dans les années 90. D’une certaine façon, les lecteurs de comics ne constituaient-ils qu’une réserve de mohicans.
Tintin, Spirou, Vaillant, Pif Gadget, Pilote, Fluide Glacial, Métal Hurlant, l’Echo des Savanes, Charlie Mensuel, À suivre… La bande dessinée, en France, était à l’origine une lecture de presse. C’était dans les journaux spécialisés (et dans la presse en général aussi) que l’on lisait les aventures de ses héros préférés. La publication en album (notamment incarnée par Astérix) était au départ extrêmement rare. C’était l’exception réservée aux séries qui avaient conquis le plus important lectorat dans le journal et qui se voyaient offrir une compilation sous forme de livre. Les années 80 ont vu le développement de ce format et dans le même temps, la réduction drastique du nombre de périodiques spécialisés en bande dessinée. La norme qui était la parution magazine, a été remplacée par l’album dès le milieu des années 90.
On le voit, le lectorat comics a finalement tenu beaucoup plus longtemps puisqu’il a fallu attendre 2020 pour voir la mort du comics kiosque. Rappelons tout de même que la BD européenne au format magazine n’a pas totalement disparu, elle, à ce jour.
De fait, on peut donc interroger la responsabilité du format album sur la fin du format magazine. Et interroger la responsabilité des éditeurs en la matière, ce qui reviendrait à se demander qui de la poule ou de l’œuf… Car les mouvements peuvent être tout à fait parallèles. Thierry Mornet nous le rappelait, « la parution de comics au format album, ce n’est pas récent. Le Futuropolis de Robial publiait dès 1974 le Popeye de Segar sous ce format-là. Ce sont eux aussi qui ont proposé une belle édition de Terry and the pirates de Milton Caniff. Dans les années 80, Fershid Bharucha lançait Comics USA, une filiale de Glénat tandis que Delcourt publiait en 1989 Elektra Assassin de Miller et Sienkiewicz. »

De quand date le grand bond vers la librairie ?
Selon Olivier Jalabert et son expérience de libraire, la fin des années 90 et le début des années 2000 était encore très expérimental : « Imaginez qu’en 2000, SEMIC publiait le comics Tomb Raider au format kiosque, mais que c’était Editions USA qui en publiait la version album à quelques mois d’intervalle. Je pense que c’est là que Panini a compris qu’il fallait rationnaliser cette offre éditoriale et concentrer les droits de publication. » Sébastien Dallain confirme et date ce revirement à la fin des années 90 : « Au départ, la librairie n’était pas au programme de Marvel France. Notre ADN, c’était le kiosque. Mais quand j’ai vu les concurrents acheter des droits spécifiques pour des parutions librairies, j’ai milité en interne pour la cohérence. Il n’était pas possible que le lecteur ne trouve pas chez nous, l’ensemble des titres de notre catalogue de licences. »
Un chemin déjà pris par Thierry Mornet avec l’offre SEMIC Books la même année. « Un peu dans le même rythme que Panini, nous avons voulu proposer une offre d’albums compilés. C’étaient les ancêtres des softcover d’aujourd’hui. Nous avions proposé des couvertures à rabats, des marque-pages, de quoi faire un objet qu’on avait envie de garder. » Une offre convertie en 100% Marvel par l’éditeur concurrent, mais des objets fondamentalement similaires, proches des Trade Paper Back américains sur le concept, dans des recueils qualitatifs mais pas luxueux.
Pourtant, ces nouvelles publications apportent rapidement des avantages qui vont sans doute faire évoluer les esprits plus rapidement. « Pour moi, ce qui a fait la force de la librairie, c’est qu’à tout moment le lecteur peut trouver ou commander le livre qu’il veut lire. En kiosque, une fois la périodicité passée, il n’était plus possible de se procurer les titres. C’était maintenant ou plus jamais, » explique Thierry Mornet.

Source :
www.https://www.maximumcomics.fr/
Le consommateur doit arbitrer ses dépenses
Et puis il faut le reconnaître, le lectorat a vieilli. Il s’est embourgeoisé. Rapidement, les formats à couvertures souples ne lui ont plus suffit. Les lecteurs ont voulu des albums à couverture rigide. Là encore, guidés par les pratiques américaines, qui avaient vu le développement du Hardcover, édition plus qualitative que le TPB. Avec un meilleur pouvoir d’achat, le collectionneur veut investir sur des objets exceptionnels, comme les Omnibus Panini, véritables briques de 600 pages. Alors les éditeurs multiplient les propositions.
Cet argent irrigue finalement moins de titres alors que la production augmente sans cesse, tous les éditeurs francophones voulant proposer des traductions de titres américains. De l’argent qui ne peut plus être placé sur les titres kiosques, qui vendant moins, finissent par être arrêtés, remarketés ou renchérits. « Les éditeurs ne voulaient pas arrêter le kiosque. Ils savent tous que ce format est générateur de nouveaux lecteurs qui iront vers d’autres produits » argumente Xavier Fournier. « Delcourt comics avait déployé trois magazines, autour de licences fortes comme Spawn, Fathom ou Top Cow » nous explique Thierry Mornet. « Mais le temps passant, les ventes baissant, il n’était plus possible de les maintenir. On ne s’attend pas à gagner beaucoup d’argent sur ces produits, ce sont d’une certaine façon des previews pour la librairie. Mais on ne peut pas non plus trop perdre. A un moment donné, même si on n’a pas envie, on doit dire stop. C’est notre responsabilité d’éditeur vis-à-vis de l’entreprise. »
Transfert de budget des lecteurs du kiosque vers la librairie ? L’hypothèse est plausible. Mais elle n’écarte pas la véritable raison de la fin brutale du format. Cette cause a un nom, elle s’appelle Presstalis.
Quand la diffusion détruit un héritage éditorial
Rares sont les éditeurs à s’exprimer publiquement sur le sujet. Xavier Fournier, essayiste et journaliste, a régulièrement décrit l’impact de Presstaliss sur le marché du comic-book en France. « Avant toute chose, il faut rappeler qu’en 20 ans, le nombre de points de vente est passé de 36 000 à près de 20 000. On ne peut pas espérer vendre autant, quand moins de lecteurs potentiels peuvent vous trouver en rayon facilement. » Sébastien Dallain met en avant un écueil supplémentaire : « Si les kiosquiers sont moins nombreux, ils ont aussi de moins en moins de linéaires pour les revues. Ils ont compris que d’autres produits leur permettent de faire une meilleure marge. Je visitais régulièrement les points de ventes. Et il n’était pas rare qu’on me dise que les comics étaient en réserve. L’achat impulsif est bien plus compliqué dans ces conditions. »

Comment ça fonctionne la diffusion kiosque ?
Il va s’agir d’être quelque peu technique. Xavier Fournier explicite le mécanisme qui permet aux lecteurs de retrouver leurs magazines chez les marchands de journaux : « Le système à l’œuvre aujourd’hui encore dans la Presse française, c’est qu’une seule entreprise appelée jusqu’ici Presstalis [NDLR : Aujourd’hui renommée France Messagerie après rachat] a le quasi-monopole de la distribution des magazines chez les kiosquiers. Pour pouvoir diffuser votre revue, vous devez donc suivre leurs règles. Pour espérer vendre 10 000 unités, vous devez en fait en imprimer 30 000 et les faire tous envoyer à travers la France. Une fois le nouveau numéro arrivé le mois suivant, les invendus sont renvoyés par les kiosquiers. Ces deux déplacements sont facturés, juste pour pouvoir être présent dans le rayonnage. » François Hercouët précise : « Nous ne recevons les chiffres de ventes et d’invendus que tous les trois mois. C’est extrêmement compliqué d’affiner l’offre éditoriale dans ces conditions. »
Tout le monde peut-il investir ce système ?
Un système gourmand mais qui fonctionna pendant des années pour la Presse, de la sortie de la guerre jusqu’à la fin des années 2010. Cependant, pour les comics, il ne fonctionnait que sur les licences les mieux établies. Olivier Jalabert, à sa prise en main du label Glénat Comics, a considéré de se lancer sur le kiosque : « Nous n’avions pas de série au long cours, pas de personnages iconiques. Investir ce marché pour le « jeune » éditeur que nous sommes sur le comic-book, aurait été présomptueux. Le modèle kiosque n’était pas tenable pour nos titres. J’avais pourtant travaillé une proposition, que nous avons utilisée comme matériel promotionnel, autour de Lazarus et Mechanika notamment. Mais il n’a jamais été crédible d’en faire un magazine. »
L’ensemble de la presse française se porte mal
À partir de juin 2018, les tensions sont vives dans l’entreprise Presstalis. Dans une présentation publique, le président du Syndicat des distributeurs de presse exprime déjà ses doutes quant au fait d’être en capacité d’être présent face à son auditoire l’année suivante. « Cela fait des années que pour l’ensemble des titres kiosque, au-delà des comics, les baisses de ventes se mesurent à deux chiffres, » énonce un Sébastien Dallain attentif à l’évolution globale du marché.
Les éditeurs de presse doivent absorber des hausses de tarifs conséquentes de la part de Presstalis. « Nous constations une attrition des revenus à chaque numéro, » révèle François Hercouët, « mais le Batman Bimestriel, 300 pages pour 12€, restait viable avec de 5 à 6 000 exemplaires par numéro. Parce que c’était Batman, d’ailleurs. En tous cas, je tenais à ce que nous restions présent sur ce format historique. J’y suis personnellement attaché, je crois en son intérêt. »
Mais pourquoi les éditeurs n’ont-ils pas quitté Presstalis ?

Autre difficulté, la plupart des éditeurs de Presse disposent d’une clause de non-concurrence dans leurs contrats les liant au diffuseur. Impossible pour eux de partir pour faire appel au seul autre concurrent, les Messageries Lyonnaises de Presse (MLP). « Dans toute la Presse, des éditeurs ont été obligés de sortir des magazines en sachant que le diffuseur courrait à sa ruine. Autrement, ils auraient renoncé à récupérer de grosses sommes que leur devait Presstalis » poursuit Xavier Fournier, beaucoup plus loquace et libre de parole sur le sujet que les éditeurs. Panini n’est plus concerné pour les comics mais Sébastien Dallain s’exprime tout de même : « Nous n’avons plus que nos magazines jeunesse, chez Presstalis. Il faut savoir que nous n’avons toujours pas été payés pour nos ventes de 2020. Ce sont plusieurs centaines de milliers d’euros qui sont pour l’instant gelés dans le cadre du processus de rachat, mais potentiellement perdus. Nous avions une solution de recours pour les comics, nous avons bien fait de nous en saisir. Sinon, nos pertes seraient encore plus grandes. Pour certains éditeurs de presse, cela se compte même en millions d’euros. »
Pendant ce temps, Urban Comics est toujours lié à l’entreprise. Le 1er juillet dernier, le tribunal de commerce de Paris a validé le rachat de la société, mise en faillite pendant le confinement, par un groupement de grands journaux français. Batman Bimestriel n°6, qui n’a pas été diffusé pendant la crise de la COVID-19, pourrait-il finalement rejoindre les kiosques ? La question n’est pas résolue à l’heure où nous écrivons ces lignes.
Pourquoi les éditeurs ne proposent-ils plus d’abonnements ?
L’abonnement aurait-il pu constituer une réponse à ces problèmes de diffusion ? La pratique était très appréciée du temps de Strange et consorts. Thierry Mornet en a eu une expérience décevante : « Quand nous avons proposé notre offre kiosque, Top Comics, Aspen Comics et Chroniques de Spawn, nous avons lancé une offre d’abonnement. J’arrivais avec une bonne connaissance du réseau après mon expérience SEMIC et Delcourt proposait déjà son propre magazine, Pavillon Rouge. Mais la réalité, c’est que nous n’avons jamais eu plus de 500 abonnés sur le même titre. Les coûts d’expédition étaient importants et les marges trop faibles. Nous avons rapidement arrêté. » Le lecteur de comics aurait-il besoin d’un contact humain dans ses achats ?

Une résurrection est-elle possible ?
Avec ce rachat et de nouvelles règles du jeu sur ce marché, est-il envisageable de voir revenir du comics en kiosque ? François Hercouët croit en cette possibilité, Sébastien Dallain ne rejette rien : « Panini Comics a quitté le kiosque du fait de la crise Presstalis. Mais je crois toujours qu’il y a une véritable pertinence à être présent sur le réseau kiosque. À ce jour, nous n’avons aucun projet et nous proposons une nouvelle offre de softcover pour accompagner l’évènement des X-Men : Dawn of X. Mais si à l’avenir, la situation économique devient plus saine et qu’il y a une opportunité de revenir dans les kiosques, nous réfléchirons à une nouvelle formule. »
Ce nouveau produit Softcover, c’est une nouvelle offre éditoriale : chaque mois, un ouvrage de 160 à 180 pages regroupant tous les numéros un puis deux, etc. des séries estampillées Dawn of X. « Nous essayons de proposer quelque chose de différent des recueils thématiques habituels. Pour l’instant, nous sommes plutôt satisfaits des retours que font nos clients sur Internet, à l’annonce de cette offre. » Un « magazine » pour lire toutes les séries X-Men, suivre la trame principale écrite par Jonathan Hickman et découvrir toutes les séries annexes moins connues. Dans un format à mi-chemin entre livre et magazine. Ce qui est, à ce jour, le format le plus proche du comics kiosque.
La responsabilité n'est pas ce qui importe
Nous ne sacrifierons donc pas aux guerres de chapelles accusant l’un ou l’autre des éditeurs de la disparition des comic-books des kiosques français. La cause de cette évolution majeure dans les modes de consommation culturelle est plus à chercher dans le vieillissement du lectorat et sa gentrification ainsi que dans les difficultés engendrées par un système de diffusion obsolète.
Reste l’enjeu de toucher de nouveaux lecteurs. Pour Xavier Fournier, les éditeurs vont devoir travailler sur l’achat d’impulsion. Ce que Panini essaye de faire avec différentes collections disponibles en supermarchés. « Il faut aller chercher le lecteur. Le fan de super-héros au cinéma n’a pas le réflexe d’aller chercher le comics. Il faut donc l’amener à lui. Renouer avec l’achat d’impulsion. Il faut soigner les fidèles, mais il faut surtout récupérer de nouveaux lecteurs. » Vaste programme.





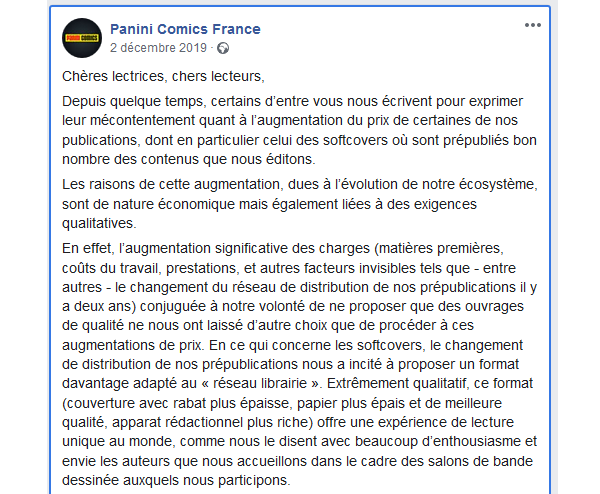
 Haut de page
Haut de page



 0
0
1


 0
0