La Journée Internationale du Livre pour Enfants est célébrée le 2 avril en hommage à la naissance du conteur danois Hans Christian Andersen, auteur de célèbres contes tels que La Petite Sirène, Le Vilain Petit Canard ou encore Les Habits Neufs de l'Empereur. Cette journée, instituée en 1967, est parrainée par l'UNESCO et l’International Board on Books for Young People (IBBY). Son objectif : promouvoir la lecture dès le plus jeune âge, lutter contre l’analphabétisme et rendre les livres accessibles à tous. Elle permet aussi de valoriser les œuvres de littérature jeunesse, un domaine en constante évolution, où la bande dessinée jeunesse occupe désormais une place de choix.
À cette occasion nous avons échanger avec Nathalie Prince, agrégée de Lettres Modernes (2015), elle est docteur en littérature générale et comparée de l’Université de Paris Sorbonne-Paris IV. En tant que chercheuse, elle a beaucoup travaillé sur la littérature de jeunesse (La littérature de jeunesse, Armand Colin, 2021) et en tant qu’autrice, elle écrit pour les petits (Aux gros mots les gros remèdes, Bel&Bien, 2024 ou La dinde savante et la poule philosophe, Pourpenser, 2021) et pour les grands (Saint-Exupéry. Du Vent dans le coeur, Calype, 2024 ou Un enterrement et quatre saisons, Flammarion, 2021).

Nathalie Prince agrégée de Lettres Modernes et docteur en littérature générale et comparée de l’Université de Paris Sorbonne-Paris IV © Eugenie Martinez
Les grands tournants de la littérature jeunesse
Dans votre essai La littérature de jeunesse, vous avez analysé l’évolution de la littérature jeunesse, quels sont, selon vous, les grands tournants de son histoire?
Nathalie Prince : Quand je raconte la petite histoire de la littérature de jeunesse, je dis souvent que nous sommes face à une pièce de théâtre en cinq actes (mais pas une tragédie !) Il y a d’abord la proto-littérature de jeunesse, sorte de premier acte, qu’on trouve dans l’Antiquité, dans les contes de tradition orale, dans les Fables d’Esope à La Fontaine. Puis, et le changement est lié à une modification du sentiment de l’enfance, très claire au XVIIème siècle, l’enfant n’est plus considéré comme un adulte miniature qui peut attraper des livres quand il y en a à la maison (ce qui n’arrive pas souvent…), mais comme un être à part à qui on écrit des livres pour lui.
Ces livres sont souvent des livres très moraux pour les redresser, leur apprendre à obéir, à bien se tenir, bref jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, les livres pour les enfants sont souvent des livres que les enfants ne lisent pas parce que trop indigestes ! C’est la littérature romantique qui va donner un peu d’air frais aux enfants avec les frères Grimm, les contes d’Andersen et puis toute cette fin du XIXème siècle en laquelle on reconnaît souvent une sorte d’âge d’or avec les classiques (c’est-à-dire ceux qu’on lit en classe) que l’on connaît tous : , Peter Pan ou encore Pinocchio.
C’est vraiment une époque où la littérature s’adresse aux enfants pour ce qu’ils sont, met en scène des enfants dans des histoires qui favorisent le déploiement de l’imaginaire et que les enfants vont adorer. Début XXème, dans les années 1920, on assiste à la naissance de la BD, avec ces textes mis dans des bulles et des personnages qui reviennent, comme Tintin, Bibi Fricotin et Mickey !
La critique reconnaît un tournant dans les années 1970 avec des éditeurs pionniers qui s’intéressent à la valeur esthétique du livre et qui s’emparent des nouvelles techniques d’impression : des collections voient le jour qui font la part belle à l’illustration et à la lecture d’images avec les albums qui font leur apparition, comme le fameux de Maurice Sendak en 1963, qui déroute par l’image et le sujet (un enfant en colère).
Depuis le début du XXIème siècle, cinquième acte, la littérature de jeunesse peut tout dire avec talent et aborde tous les sujets, la guerre, la Shoah, les questions de genre, la question de la catastrophe environnementale, la violence, le drame des migrants, la violence conjugale… Tout peut être mis entre les mains des enfants à condition de bien le dire. Parce que l’enfant n’est pas un lecteur comme les autres, il a besoin d’une « autre » littérature comme j’aime l’appeler. Pas une sous-littérature, mais bien une littérature supérieure aux autres (parce qu’elle nous marque à tout jamais) et qui peut être lue par tous, même par les enfants !
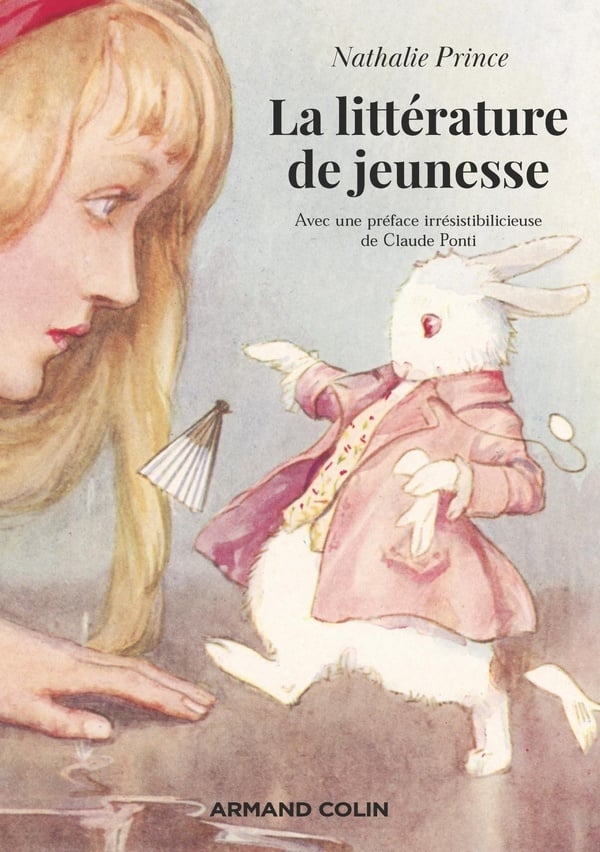
La Littérature de jeunesse, Paris, Armand Colin, 2021 © Nathalie Prince
La bande dessinée jeunesse doit-elle être considérée comme un sous-genre de la littérature jeunesse ? Quelle place occupe-t-elle aujourd’hui ?
N.P : Si longtemps la bande dessinée a été perçue comme un sous-genre, cette vision estlargement dépassée. Pour preuve les formidables festivals de BD comme à Blois ou à Angoulême ou les prix qui lui sont attribués. C’est une expérience de lecture à part, que l’on accroche ou pas, qui prend une place très importante dans le paysage littéraire (et pas que dans le paysage littéraire des jeunes !) C’est une autre manière de lire, une autre expérience de lecture, une manière de relire aussi (comme Le petit Prince ou La Quête d’Ewilan en BD, mais aussi comme La recherche du temps perdu ou Le Horla aujourd’hui disponibles en BD !). Sans compter les séries culte, des Légendaires à Mortelle Adèle.
La BD et un support de médiation qui est peut-être plus accessible pour certains lecteurs qui décrochent et ça permet une démocratisation de la lecture. Et je ne parle pas des mangas, qui appartiennent à la famille des bandes dessinées, avec leurs propres spécificités culturelles. Le succès de la série One Piece dans laquelle les jeunes s’immergent totalement est incontestable.
Un format intergénérationnel
La bande dessinée pour enfants attire aussi bien les enfants qui les adolescents et les adultes. Comment expliquer cet attrait intergénérationnel ?
N.P : J’ai envie de vous dire que c’est pareil que la littérature de jeunesse en général, qui plaît autant aux enfants qu’aux parents (et d’ailleurs pour arriver entre les mains des enfants, il faut une médiation adulte). La bande dessinée est intergénérationnelle pour mille et une raisons : rappelez-vous d’Hergé qui destinait ses Tintin à tous les lecteurs de 7 à 77 ans, ce qui est restrictif, me direz-vous, parce qu’aujourd’hui, on crée des livres pour les bébés et que les plus de 77 ans ont encore de belles lectures à faire !
Dans la mesure où la bande dessinée et les romans graphiques (qu’on ne doit pas oublier !) abordent tous les thèmes, chacun y trouve le livre qui lui plaira. On sait ce qu’on va trouver dans Astérix (entre autres de bonnes rigolades). On sait qu’on peut y trouver de la vulgarisation scientifique (comme dans de Vincent Lemire et Christophe Gaultier). Les amateurs de mythologie y verront leurs héros préférés en chair et en bulle (la BD, c’est du visuel) et les plus jeunes se précipiteront sur les webtoons (ces BD numériques adaptées au scrolling) via leur smartphone. A chacun sa bande dessinée ! L’image, qu’elle soit rigolote ou carrément sensuelle, voire érotique (ça plaît aussi beaucoup), trouve toujours sa cible.
Personnellement, j’ai beaucoup travaillé en tant que spécialiste de la littérature pour la jeunesse sur Peter Pan, le roman de James Matthew Barrie, mais je suis une inconditionnelle de la bande dessinée de Régis Loisel, à ne pas mettre entre les petites mains. Et pour entrer dans l’univers de Barrie avec mes étudiants, je suis passée par la BD de Loisel. Le même Peter Pan existe pour tous les âges, chez Glénat, Bamboo éditions, petit à petit, Disney et Vent d’Ouest !
Pensez vous que le format visuels de la bande dessinée attire particulièrement les jeunes lecteurs ? Quels sont les avantages et les défis ?
N.P : C’est évidemment un atout majeur. On est dans une génération de l’image. Aujourd’hui, la communication, l’information et même la culture passent majoritairement par des supports visuels (omniprésence des écrans et du numérique, téléphone et autres réseaux sociaux). Ça va vite et l’impact émotionnel est immédiat sinon plus fort.
La bande dessinée convient davantage au mode de lecture fragmenté (vidéos courtes, stories) au détriment de la lecture linéaire et du texte long. C’est un format particulièrement séduisant pour les jeunes, qui vont suivre la narration sans être freinés par un texte trop dense, qui se sentiront davantage en terrain familier (les images, ça leur parle !) et qui se sentiront davantage captifs et capable d’immersion. Mais il ne faut surtout pas croire que l’esprit critique n’y trouve pas son compte.
Certes, on est davantage dans la réaction immédiate que dans l’analyse approfondie, mais l’éducation s’adapte (cartes mentales par exemple). Lire l’image, ce n’est pas inné, pas plus que lire en même temps un texte et une image en termes de charge cognitive (et je mets au défi pas mal d’adultes sur la manière de lire un manga !) Aller au bout des quelques 110 tomes de One Piece, c’est une véritable gageure, et quelle satisfaction d’être allé au bout pour un jeune addict aux réseaux sociaux face au déroulement infini ! Se dire qu’il a terminé une histoire, c’est déjà une petite victoire ! Et le plaisir de la lecture est aussi une très bonne raison pour défendre la BD (qui n’a pas besoin d’être défendue).
Quels conseils donneriez-vous aux auteurs et illustrateurs qui souhaitent s’inscrire dans le domaine de la littérature jeunesse aujourd'hui ?
N.P : Oh la la ! Je ne me sens pas légitime pour donner des conseils à des auteurs et encore moins à des illustrateurs. C’est une grande responsabilité que d’écrire pour les enfants. Il ne faut pas les sous-estimer mais il ne faut pas non plus leur donner des leçons. On peut avoir en tête l’adulte qui lira par-dessus l’épaule de l’enfant et s’amuser aussi à lui faire quelques clins d’œil. Si l’enfant ne comprend pas tout de suite, pas grave. Il comprendra plus tard ! Il faut avoir de belles histoires dans le cœur avec des personnages forts.
Personnellement, je pense que l’humour est capable de tout et c’est une de mes façons d’écrire.
J’aime travailler sur les émotions, comme dans mon dernier roman jeunesse (8-10 ans) au sein duquel une petite fille très en colère ne s’exprime qu’avec des noms d’oiseaux (au sens propre), du style « gros canard » ou « va te faire plumer chez les chouettes » !) Les enfants rient, les parents rient… C’est un bon début pour raconter les problèmes (pas drôles) de communication entre un père taiseux et une petite fille qui a envie d’en découdre (cf Aux gros mots les gros remèdes, Nathalie Prince et Aimeé Forêmar, Bel et Bien éditions, 2024).
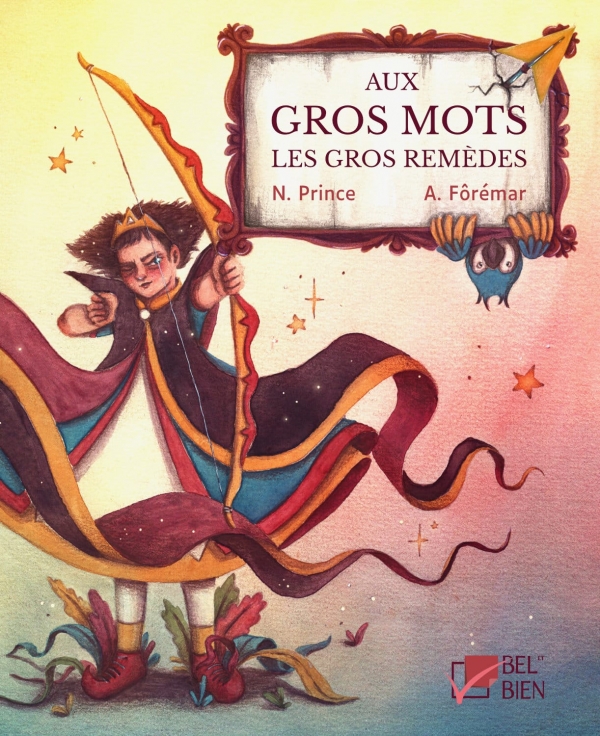
Aux gros mots les gros remèdes, Bel et Bien éditions, 2024 © Nathalie Prince et Aimeé Forêmar
Littérature jeunesse et nouveaux formats
Face à la digitalisation croissante des jeunes générations, que pensez-vous des nouveaux formats comme les livres audio, les applications, les webcomics… ?
N.P : Je ne suis pas inquiète parce que depuis quatre cents ans, la littérature pour la jeunesse a déjà su s’adapter de très belle manière ! Elle continuera de s’adapter. C’est darwinien. Je dis dans l’ouvrage que vous avez cité (cf. La littérature de jeunesse, Armand Colin, 2021) qu’elle renouvelle tous les genres littéraires et tous les questionnements sur la littérature. Qu’elle est une caisse de résonance et un laboratoire d’expériences, qu’elle sait inventer son lecteur (comme JK Rowling avec Harry Potter), qu’elle est capable aussi bien de répéter (les contes de fées, les stéréotypes comme le loup) que fabriquer du nouveau (les lectures audios, les webcomics, qui sont des histoires sur applis, ou le travail sur les supports et les matières).
Alors à l’évidence, la digitalisation transforme lespratiques de lecture des jeunes mais il ne faut pas forcément y voir une menace. Aujourd’hui on propose même de la critique littéraire pour enfants et L’Affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais invente une nouvelle manière de lire, façon enquête policière. Je trouve que c’est une très bonne nouvelle !
Les enfants ont de plus en plus de troubles dys- ? Les audiobooks peuvent les aider, tout comme les éditeurs engagés avec des collections en gros caractères. Les éditeurs s’adaptent. Aux gros mots les gros remèdes est d’ailleurs édité en ce sens, dans la collection « Gros Mots » (au sens propre et au sens figuré) et les grands-parents qui peuvent peine à lire les petits caractères sont ravis !
Aujourd’hui, le livre pour la jeunesse est partout mais certains ne le voient pas : on a le petit prince dans l’assiette (ou à l’Atelier des Lumières à Paris) ; on a nos héros préférés sur nos vêtements ; on voit Harry Potter au cinéma avant de le lire sur papier. N’est-ce pas une preuve de plus que la littérature de jeunesse est capable de tout (et encore pour longtemps ?). Il faut sortir de la nostalgie qui abîme et accepter la vague. Au lieu de se laisser couler, il faut essayer de tenir en équilibre dessus et avec le sourire en plus !
À travers ses analyses, sa réflexion et ses propres créations, Nathalie Prince souligne la responsabilité d’écrire pour les jeunes, tout en rappelant que la littérature jeunesse est avant tout un espace d’expérimentation et d'invention. En un mot, elle se réinvente continuellement, tout en restant fidèle à sa mission : éveiller les imaginaires, aborder des thèmes de société essentiels et, surtout, offrir aux jeunes une expérience de lecture inédite.
Loin d’être un sous-genre, elle s’impose comme une forme à part entière, capable de captiver à la fois les jeunes et leurs parents, et même d’attirer les adolescents et les adultes, sur tous les sujets même les plus difficiles. Elle s'adapte aussi aux évolutions numériques, avec l’émergence des webcomics, des livres audio et des formats interactifs, sans perdre de son impact émotionnel et de sa capacité à susciter la réflexion.
Interview
Jeunesse

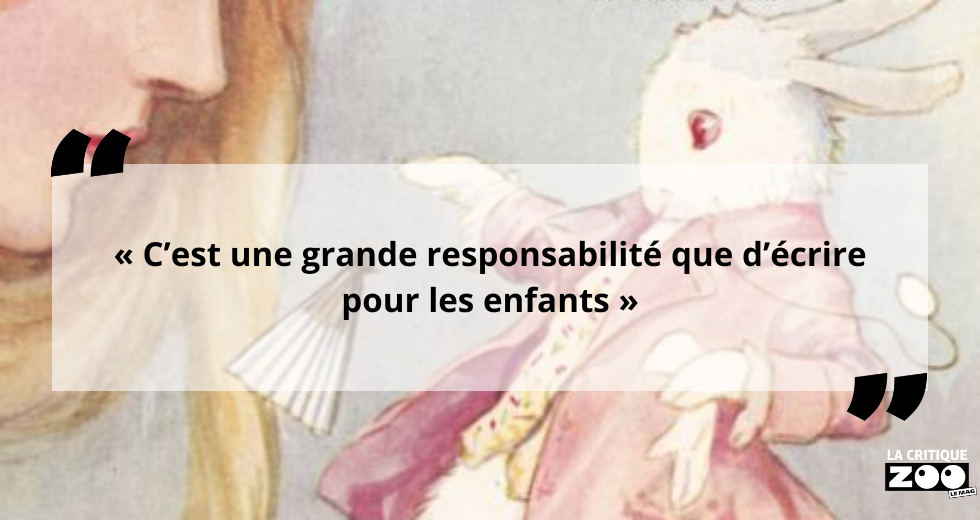



 Haut de page
Haut de page
Votre Avis